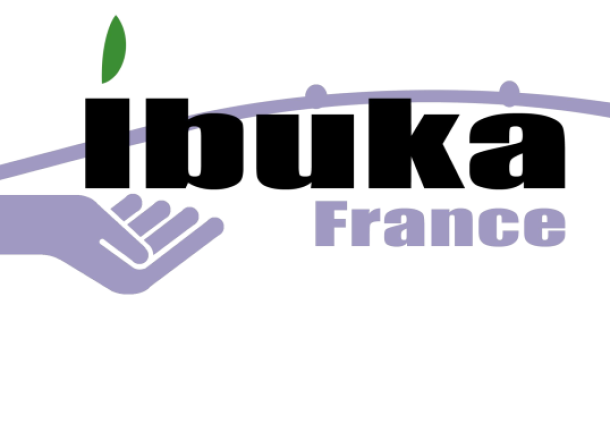actualités
"Construire le monde d'après" : le témoignage de César Murangira à Bons-en-Chablais
Dans le cadre du projet “Construire le monde d’après”, une soixantaine d’élèves du collège Jean-François Mugnier à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie) a assisté au témoignage poignant de César Murangira, rescapé du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994. Cette initiative, portée par la Ligue de l’enseignement et l’association Ibuka France, vise à accompagner enseignants et élèves dans l’accueil d'un témoignage en classe, en garantissant un cadre pédagogique sécurisant.
ce que le témoignage fait
Il est 15h au collège Jean-François Mugnier de Bons-en-Chablais. Dans la salle d’animation du rez-de-chaussée, les chaises sont prises d’assaut. Une soixantaine d’élèves de 3e s’installe dans le calme et les premiers rangs sont rapidement remplis. « C’est rare pour des élèves de 14 ans », remarque, sourire aux lèvres, César Murangira, président de l’association Ibuka Suisse. Venu spécialement de Fribourg, il témoigne sans relâche depuis 2003 : d’abord dans sa ville, puis à l’ONU. « Je n’ai jamais vraiment arrêté », confie-t-il juste avant l’entrée des élèves.
Une intervention préparée avec soin
Ce moment fort s’inscrit dans un long travail pédagogique mené depuis septembre par trois enseignantes engagées : Madame David (histoire-géographie), Alexandra Houllier (lettres) et Kristy Kazemajou (arts plastiques). Leur projet : la mémoire des conflits du XXe siècle, abordé grâce à l'étude d'une diversité de supports artistiques et littéraires. Les élèves ont déjà rencontré une rescapée de la Shoah et des témoins de la guerre d’Algérie. Ils se sont également rendus aux Archives départementales et au mémorial de Montluc.
Pour préparer la venue de César, les enseignantes se sont appuyées sur des ressources puissantes : les poèmes de Béata Umubyeyi Mairesse, les écrits de Jean Hatzfeld, ou encore le reportage photographique de Jonathan Torgovnik. Nombre de ses ressources sont répertoriées sur le site Enseigner Témoigner, où les enseignant.es et les élèves peuvent se rendre pour trouver du contenu adapté aux programmes scolaires. L'étude d'une ou plusieurs de ses ressources est une des conditions sinequanones à la participation des classes au projet Construire le monde d'après. Les élèves ont également étudié le contexte historique et les mémoriaux rwandais, visités par Madame David lors de son voyage d'études au Rwanda, organisé l'an dernier par l'association Ibuka France.
"j'ai compris que j'étais tutsi à 6 ans, quand je suis entré à l'école"
César raconte son enfance : les loisirs, le scoutisme, le football… mais aussi les brimades, les insultes, la ségrégation. Et surtout, le silence de ses parents face à ses interrogations quant à son identité Tutsi. "J'ai compris pourquoi plus tard, ils voulaient me protéger de ce que qu'ils vivaient depuis les années 50". En effet, les persécutions contre les tutsi ont débuté des années avant le génocide, installant un cadre propice pour ce qui allait suivre. Ainsi, en 1994, César a 20 ans. La guerre le rattrape alors que la vie semble encore pleine de promesses. « On imaginait notre avenir, on espérait toujours », souffle-t-il.
Puis vient la nuit du 6 avril. César regarde un match de la Coupe d’Afrique des Nations. Un ami de longue date lui dit : « Le président aurait dû vous tuer tous ». Quelques heures plus tard, l’avion du président Habyarimana est abattu. Le génocide commence.
Une écoute suspendue
Dans la salle, la ventilation du réfectoire s'interrompt et le silence devient total. Les élèves, concentrés, sont suspendus au récit. César raconte la fuite, les cris, la peur, les morts. Il dit, avec pudeur : « C’était pas simple ».
À la fin de son récit, il demande aux élèves ce qu’ils ressentent. Deux garçons répondent, un peu sonnés :
– « C’est presque un film… ça n’a pas l’air réel. »
– « C’est compliqué à entendre. C’est violent. »
L’après, entre résilience et engagement
Il évoque Joséphine, sa « deuxième maman », rencontrée pendant le génocide, puis l’arrivée du FPR, la libération de Kigali, et son engagement aux côtés des rebelles. La voix reste posée, mais l’émotion affleure. Les élèves, eux, écoutent respectueusement et attentivement ce témoignage, qui ici, prend tout son sens : c'est un don.
César finit son récit en retraçant son parcours après le génocide : son retour au collège, ses études en Suisse, une vie qu’il reconstruit, et un engagement politique et associatif constant.
« La justice, pour moi, ce serait qu’on ramène les miens, qu’on compense ces années sans eux... Parfois, j’aimerais juste boire un café avec ma sœur. 20 minutes. Mais je ne peux pas. »
Des questions essentielles
La dernière partie de la rencontre est consacrée aux échanges. Les élèves interrogent César sur le traumatisme, le deuil, la santé mentale, ou encore le négationnisme. César insiste sur l’importance de la mémoire et de la vigilance citoyenne :
« Tous les discours de discrimination banalisés ont fait de nous des cibles. »
Et d’ajouter, grave :
« L’être humain est capable du pire si on n’est pas vigilant. »
LA MÉMOIRE COMME HÉRITAGE
Au-delà de la richesse d'un tel moment, la rencontre avec César s’inscrit dans une démarche pédagogique ambitieuse : celle de transmettre une mémoire vivante, incarnée, et de nourrir la réflexion des élèves sur les discriminations, la construction d'un génocide et le danger de la désinformation. En amont de cette rencontre, les classes avaient préparé, avec leurs professeures, une restitution sensible sous forme de dessins, d’illustrations de poèmes et de récits, conçue à partir des ressources étudiées en classe. Ce travail, réalisé avec soin et engagement, représente un bel échange symbolique, leurs créations ont précédé la parole partagée, établissant un dialogue entre le témoignage et sa transmission.

César raconte aussi son histoire dans son livre Un sachet d’hosties pour cinq, dont il prépare actuellement une nouvelle édition. Malgré ses nombreux engagements, il tient à poursuivre ses déplacements, en Suisse comme en France, pour continuer à témoigner et lutter, à son échelle, contre l’oubli et l’ignorance.

partenaires